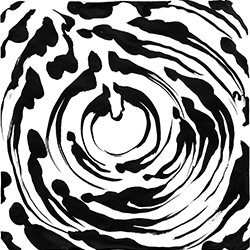Notes & bibliographie
1. M. FOUCAULT, L’archéologie du savoir (abrév. AS), Paris, coll. Tel/Gallimard, 1969, p.240.
2. M. FOUCAULT, « Homère, les récits, l’éducation, les discours » (abrév. HRED), une série de feuillets inédits transcrits et présentés par Martin Rueff, La Nouvelle Revue Française n°616, janvier 2016, feuillet [2 recto].
3. M. FOUCAULT, Le discours philosophique (abrév. DP), Ed. établie, sous la responsabilité de F. Ewald, par O. Irrera et D. Lorenzini, Paris, Gallimard, 2023, p.254 et p.258.
4. Pour Foucault, expérience et constitution du sujet (! Foucault parle de formes du sujet ou de subjectivités) sont deux notions qui se rejoignent dans la rationalisation d’un processus provisoire. Très brièvement : Premièrement, Foucault part du principe que le sujet ne préexiste pas à ce qui le constitue. Le sujet peut et doit se constituer/se subjectiver dans un processus dans lequel il est lui-même « actif », même de manière infime : tout sujet existe dans des rapports à la vérité noués à des savoirs et des relations de pouvoir selon des modalités historiques, et donc est sans cesse engagé dans un processus de constitution ou un mode de subjectivation. Deuxièmement, le sujet se constitue à travers un processus de subjectivation et d’objectivation tel qu’il est amené à éprouver des expériences possibles vérifiées/vérifiables par des discours (vrais) : le sujet finit par se reconnaître et s’énoncer en même temps qu’il est reconnu par les autres sous la forme d’un objet de connaissance. Autrement dit, l’expérience d’un certain rapport à la vérité, éprouvée/vécue par le sujet, est rationalisée par le sujet et par les autres simultanément. Troisièmement, l’issue du processus aboutit à un sujet, ou plutôt, des formes du sujet ou des subjectivités. Enfin, ce processus est provisoire étant donné qu’il se crée en son sein à un moment donné, avec l’histoire. Les subjectivités sont donc toujours situées dans une histoire qui est celle de leur propre formation et transformation : de leur constitution. En bref : une expérience, c’est la rationalisation de quelque chose qui est éprouvé/vécu par le sujet et validée par un discours (vrai). Et cette rationalisation ne se fonde plus sur une théorie de l’objet (cf. la conception traditionnelle de l’épistémologie et de l’histoire des savoirs) mais sur des conditions contingentes et historiques qui rendent un certain rapport à la vérité « visible et énonçable » par soi mais aussi par les autres.
Voir Dits et écrits, « Entretien avec Michel Foucault » (1978), Paris, Gallimard, 1994, t.4, p.47 : « Une expérience est quelque chose que l’on fait tout seul, mais que l’on ne peut faire pleinement que dans la mesure où elle échappera à la pure subjectivité et où d’autres pourront, je ne dis pas la reprendre exactement, mais du moins la croiser et la retraverser ». Quelques années plus tard, in Dits et écrits, « Le retour de la morale » (1984), op. cit., p.706, il précise : l’expérience, c’est « la rationalisation d’un processus, lui-même provisoire, qui aboutit à [la formation et la transformation d’] un sujet », plutôt à des sujets. J’appellerai subjectivation le processus par lequel on obtient la constitution du sujet, plus exactement d’une subjectivité, qui n’est évidemment que l’une des possibilités données d’organisation d’une conscience de soi.»
5. Dans Les mots et les choses et L’archéologie du savoir, Foucault montre que le savoir est une pratique autonome extérieure aux mots et aux choses. Selon lui, on ne peut pas penser que le réel constitue en lui-même la raison d’être d’un discours, quel qu’il soit, et encore moins d’une vérité entendue comme adéquation. Le réel ne peut pas servir pour établir un discours qui dirait vrai sur lui-même, car il n’y a rien dans le réel qui exige qu’un discours s’articule et rende compte en vérité de ce qui se passe dans la réalité, tout simplement, parce que la réalité est muette ; le réel est juste le réel. Début des années 80, après avoir mené plusieurs enquêtes archéologiques et généalogiques, Foucault dira explicitement : « L’existence d’un discours vrai, d’un discours véridique, d’un discours à fonction de véridiction [l’existence d’un discours qui prétend dire ce qui est] n’est jamais impliquée par la réalité des choses dont il parle. Il n’y a pas d’appartenance ontologique fondamentale entre la réalité d’un discours, son existence, son existence même de discours qui prétend dire le vrai, et puis le réel dont il parle. Le jeu de la vérité [Foucault préfère donc parler de « jeu de la vérité » en lieu et place de la « vérité »] est toujours, par rapport au domaine où il s’exerce, un événement historique singulier, un événement, à la limite, improbable par rapport à ce dont il parle [autrement dit : au discours lui-même]. Et c’est précisément cet événement singulier, en quoi consiste l’émergence d’un jeu de vérité, qu’il faut essayer de restituer. » in Subjectivité et vérité, Cour au Collège de France 1980-1981, Paris, Gallimard, 2014, p.224. Cette remise en question de la notion de vérité entraîne dans son sillage la notion de sujet connaissant, ou peut-être il conviendrait mieux de dire que Foucault mène ces deux problématiques de front : dans l’Histoire de la folie à l’âge classique et Naissance de la clinique, il cherche à montrer que le sujet n’est pas originaire, pré-donné, mais qu’il se constitue (se subjectivise) comme effet de discours qui sont considérés comme vrais, qui circulent comme vrais ou qui sont imposés comme vrais. Et simultanément, le sujet s’objective par rapport à un régime de vérité qui valide son actualité. C’est finalement en 1984 que Foucault dira : « Je pense qu’il n’y a pas de sujet souverain, fondateur, une forme universelle de sujet qu’on pourrait retrouver partout. Je pense au contraire que le sujet se constitue à travers des pratiques d’assujettissement [il fait référence aux techniques de pouvoir-savoir], ou, d’une façon plus autonome, à travers les pratiques de libération, de liberté, comme, dans l’Antiquité [il fait référence aux techniques de soi], à partir, bien entendu, d’un certain nombre de règles, styles, conventions, qu’on retrouve dans le milieu culturel. » in Dits et écrits, tome IV, « Une esthétique de l’existence » [1984], Paris, Gallimard, 1994, p.733. En bref, Foucault remet en cause, dès ses premiers travaux, la notion de vérité et la catégorie du sujet, sa souveraineté et sa nature constituante. Il n’y a pas un sujet mais des formes du sujet ou des subjectivités nouées à des jeux de vérité (des jeux de savoir et des jeux de pouvoir). Dans les années 80, il découvre les techniques de soi (cf. son « retour aux Grecs ») et reconnaît avoir trop insisté sur le nexus pouvoir-savoir et revient sur l’exercice du pouvoir ou le gouvernement au sens large : le sujet n’est pas simplement traversé et informé par des gouvernementalités extérieures, il se construit au moyen d’exercices réguliers dans un rapport de soi à soi qui ont des effets sur lui-même et sur les autres. Foucault reconsidère alors son travail accompli pendant une vingtaine d’années et pose cette fois clairement la question du sujet, ou plutôt la question de la subjectivation à travers des discours vrais ; sa manière de revenir sur les notions de vérité, discours et subjectivité, ou de ne jamais les avoir quittées.
6. AS, p.71.
7. Dans Les mots et les choses, Foucault montre que l’ordre du discours ou ce qui noue une chose et un mot varie avec l’histoire ; plusieurs épistémès se sont succédé et continuent de se déplacer : l’épistémè de la Renaissance fondée sur la ressemblance (le visage du monde se couvre de signes extérieurs et visibles – des caractères, des logotypes, des chiffres, des mots, etc. – pour désigner et décrire les choses) cède sa place au début du XVIIe siècle à l’épistémè de l’âge classique fondée sur la représentation (le langage assume un nouveau rôle : celui de représenter la pensée). Ensuite, au XIXe siècle, l’épistémè moderne ou la discursivité s’impose. Pour le montrer, Foucault s’intéresse d’abord à la fabrique du savoir ou aux discours de vérité. Mais comme nous allons le voir, il s’intéresse également aux autres énoncés dans le but de définir la notion de discours en général. Lire plus sur la notion d'épistémè : https://lespacedudiscours.be/la-notion-d-episteme-chez-foucault.html
8. AS, pp.70-71.
9. AS, p.162.
10. M. FOUCAULT, Subjectivité et vérité, op. cit., p.224. Notons qu'après avoir parlé de « règles de formation », « formation des stratégies », « pratiques discursives » dans L’archéolgie du savoir, Foucault utilise le terme de « jeux de vérité » qui ont la forme de science ou qui se réfèrent à un modèle scientifique, ou des jeux de vérité comme ceux que l’on peut trouver dans les institutions ou des pratiques de contrôle. Dans les années 80, alors que ses travaux et sa réflexion se portent sur la généalogie du sujet, il change encore de vocabulaire pour parler de « techniques de vérité » qui ont le forme de techniques de savoir, de techniques de pouvoir et de techniques de soi (ou de gouvernementalité).
11. Ibid.
12. AS, pp.279-282.
13. AS, p.246. Foucault donne comme exemple la folie : elle apparaît en Occident au XIXe siècle sans pour autant recouvrir la discipline naissante de la psychiatrie – la folie « ce n’est pas la somme de ce qu’on a cru vrai, c’est l’ensemble des conduites, des singularités, des déviations dont on peut parler dans le discours psychiatrique » ; elle n’est pas une discipline mais la manifestation d’un savoir ou d’une positivité qui émerge à un moment donné. Toutefois, ce sont bien les choses effectivement dites sur la folie, les discours sur la folie, qui constituent les premiers éléments ou conditions de possibilité de la science médicale de la maladie mentale.
14. AS, p.247.
15. AS, p.109 et p.240. Voir également « Se débarrasser de la philosophie » in Michel Foucault, entretiens, Ed. établie par R.-P. DROIT, Paris, Odile Jacob, 2004, p.78 : « Des gens ont fait l’histoire de ce qui se disait au XVIIIe siècle en passant par Fontenelle, ou Voltaire, ou Diderot, ou La nouvelle Héloïse [sic]. Ou encore, ils ont considéré ces textes comme l’expression de quelque chose qui, finalement, n’arrivait pas à se formuler à un niveau qui aurait été plus quotidien. À l’égard de cette attitude, je suis passé de l’expectative (signaler la littérature là où elle était, sans indiquer ses rapports avec le reste) à une position franchement négative, en tentant de faire réapparaître positivement tous les discours non littéraires qui ont pu effectivement se constituer à une époque donnée, et en excluant la littérature. »
16. Théorie qui valait encore dans la pensée moderne au moment de ses études dans les années 50 (défendue par l’hégélianisme et la phénoménologie) et qui considérait le sujet connaissant « comme quelque chose auquel on ne touchait pas. » in « Entretien avec Michel Foucault » avec M. Watanabe [1978], Dits et écrits, Paris, Gallimard, 1994, t.4, p.43.
17. HRED, feuillets [10] à [12].
18. HRED, feuillet [16].
19. HRED, feuillet [4 recto].
20. Nous faisons la distinction entre d’une part, les conditions d’existence ou de possibilité du discours en général – qu’est-ce qui fait qu’il y a discours et que faut-il entendre par discours ? – et d’autre part, les conditions de possibilité d’un discours en particulier – pourquoi ce discours-là plutôt qu’un autre. Nous traiterons ici que des conditions d’existence ou de possibilité du discours en général, c’est-à-dire de la discursivité et du discours en tant d’événement discursif. La question des conditions de possibilité d’un discours en particulier consistant à restituer ce que Foucault appelle les « jeux de vérité », à savoir des jeux de pouvoir-savoir et des techniques de soi.
21. HRED. Martin Rueff précise tout de suite dans son introduction : « L’éducation, ce n’est pas l’éducation au temps d’Homère, mais L’éducation sentimentale, le chef-d’œuvre de Flaubert. »
22. Derrière l’analyse littéraire, c’est bien de la critique dont il est question – on sait que la notion de critique est centrale chez Foucault. Il s’agit ici de la critique telle qu’il la définit dans « Les nouvelles méthodes d’analyse littéraire » in M. FOUCAULT, Folie, langage, littérature (abrév. FLL), Ed. établie par H.-P. Fruchaud, D. Lorenzini et J. Revel, Paris, Vrin, 2019, pp.133-148. La critique n’a plus pour fonction de « faire la critique – de parler des livres des autres, de les juger, de les comparer entre eux, de les recommander ou de les condamner. […] – ce rôle, nul n’en est actuellement titulaire. Non pas qu’il n’y ait plus de candidats. Mais tout simplement le rôle lui-même n’existe plus. [Aujourd’hui], ces actes naissent d’eux-mêmes dans une sorte d’anonymat, à partir du langage. […] La critique, c’est devenu une certaine fonction constante du langage par rapport à lui-même. […] Ce n’est plus une instance de décision, c’est une forme de coexistence ». Autrement dit : la critique littéraire est désormais un discours qui trouve ses conditions d’existence dans les textes littéraires eux-mêmes.
23. HRED, feuillet [2].
24. HRED, feuillets [7] et [10].
25. HRED, feuillet [10].
26. HRED, feuillet [21].
27. HRED, feuillet [23]. Nous citons pour indiquer l’usage de la forme « discursive » pour parler de la production d’énoncés fictifs.
28. HRED, feuillet [24].
29. HRED, feuillet [29].
30. HRED, feuillet [31].
31. Au même moment où Foucault écrit ces feuillets.
32. HRED, feuillet [41].
33. HRED, feuillet [44].
34. Ibid.
35. HRED, feuillet [48]. Cette irruption du présent semble échapper à Flaubert. Foucault explicite : « Le démonstratif utilisé ici par Flaubert indique le moment précis du temps où le grand discours muet qui a recueilli les personnages et leur histoire [la voix du récitant anonyme], qui pendant si longtemps a doublé leurs gestes, leurs allées et venues, leurs sentiments, leurs pauvres passions pour les restituer au jour, achève enfin de dicter à l’auteur [la voix de Flaubert ou de son personnage principal] cette œuvre à laquelle ils doivent tous leur existence. L’irruption de ce présent, flottant presque sans date, au dernier chapitre de L’éducation, assure exactement les fonctions de l’invocation homérique ; mais elle l’inverse ; elle en inverse la place sans l’œuvre, mais elle en inverse aussi la direction puisqu’elle ne pointe pas vers l’infaillible mémoire mythique, mais vers le simple et menu geste d’écrire. »
36. HRED, feuillet [46].
37. HRED, feuillet [49].
38. HRED, feuillet [54].
39. HRED, feuillet [10 verso].
40. Ibid.
41. HRED, feuillet [3 verso].
42. HRED, feuillet [4 recto].
43. HRED, feuillet [6 verso].
44. HRED, feuillet [7 verso]. Foucault ajoute que « Un discours peut bien intimer à quelqu’un de faire quelque chose ; il se distingue pourtant radicalement d’un ordre, car l’ordre ne désigne sa nature de commandement et le résultat qu’il veut obtenir que par sa structure grammaticale, et les mots utilisés. […] Un discours est un ensemble d’énoncés parmi lesquels certains se rapportent à tous les autres désignant quels actes sont effectués ou visés par les paroles prononcées ». Foucault complétera l’analyse du discours dans les années 70 avec la notion de gouvernementalité ou comment les relations de pouvoir s’introduisent dans le discours.
45. Termes entre guillemets in HRED, feuillets [8 verso] à [10 recto].
46. HRED, feuillet [34].
47. HRED, feuillet [10 verso].
48. HRED, feuillet [11 verso].
49. HRED, feuillet [12 recto].
50. HRED.
51. HRED, feuillet [13 verso].
52. FLL.
53. FLL, p.227.
54. FLL, p.228.
55. FLL. Foucault pense à Blanchot bien sûr qui a été le premier à invoquer la présence du dehors ou de l’extralinguistique de l’œuvre, car c’est à l’absence de cette présence qu’il prêtait sa voix.
56. FLL, pp.229-240. Foucault qualifie l’extralinguistique d’« immanent » pour parler de l’extralinguistique dans la littérature dont le contexte est particulier : (1) la parole a la possibilité et le droit de tout dire, elle est en quelque sorte infinie et indéfinie (« un énoncé littéraire ouvre une classe de sens absolument infinie ») ; (2) la position du sujet parlant (racontant) peut être incertaine, voire absente, seule la lexis se fait entendre ; (3) l’acte même de la parole ne consiste plus à dire la vérité mais à raconter une fiction. Alors que dans le langage non littéraire, le contexte est assuré par des choses réelles, des contenus informatifs supposés existants, des affirmations personnelles rapportées au sujet parlant ou sous la forme d’une neutralité qui renvoie sans oscillation à un auteur nommé ou anonyme qui énonce ce qu’il sait ou ce qu’il pense ; les figures ou caractéristiques du discours sont saillantes et les énoncés sont vraisemblables. En bref, il s’agit de l’extralinguistique qui se manifeste dans les énoncés de l’œuvre même.
57. M. FOUCAULT, « La pensée du dehors » in Dits et écrits, Tome 1, 1954-1975, texte n°38, Quarto Gallimard, 1994, p.546.
58. FLL, p.240.
59. HRED, feuillet [14 verso].
60. Certes comme il l’explique : précédemment, le discours reposait sur un univers prédiscursif et l’acte de parole consistait à ranimer et restituer la chose dans ses conditions d’origine, exclusivement ; le discours était référé et avait toujours un mode d’être second : « le discours conservé était tout entier tourné vers d’éventuels actes de parole dont la possibilité, la nature et la forme étaient prévues à l’intérieur de ce discours. […] Toute son existence était liée d’entrée de jeu à un domaine plus fondamental que lui, où il prenait place pour servir d’universel instrument. » in DP, p.245.
61. DP, pp.247-248.
62. DP, p.245.
63. M. FOUCAULT, « L’ordre du discours », Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 décembre 1970, édition basée sur le texte proposé par l’édition CD-ROM, Le Foucault Électronique (2001), p.4.
64. Fin des années 60, alors que Foucault étudie la formation des pratiques discursives, il émet l’hypothèse que les savoirs sont déterminés dans une certaine mesure par trois types de procédures (externes aux discours). Premièrement, le désir (du sujet de connaissance) n’est pas absolu, il peut être soumis à « l’interdit », « au partage et rejet » et à « l’opposition du vrai et du faux » ou « volonté de vérité », trois grands systèmes d’exclusion qui ont comme point commun d’être aux mains d’institutions, donc soumis à une forme de pouvoir. Mais ce désir peut aussi être « limité » par des procédures internes (par les discours eux-mêmes) qui ont pour objet de classer, ordonner, distribuer les énoncés, comme s’il s’agissait cette fois de maîtriser une autre dimension du discours : celle de l’événement et du hasard. Foucault fait référence au principe du commentaire, à l’auteur et à l’organisation en disciplines. Il termine en mentionnant un troisième groupe de procédures qui contrôlent/régulent cette fois l’accès au discours : « les rituels de parole », « les sociétés de discours », « les groupes doctrinaux » et « les appropriations sociales » ou systèmes d’éducation, « disons d’un mot que ce sont là les grandes procédures d’assujettissement du discours. » in M. FOUCAULT, « L’ordre du discours », op. cit. Au cours des années 70, il mène différentes enquêtes et fait effectivement émerger le lien circulaire entre les régimes de vérité et les régimes de pouvoir en s’appuyant sur le modèle nietzschéen de « volonté de puissance » ; il introduit les notions de lutte, de domination et rapport de forces dans les jeux de vérité : « Discours bataille et non pas discours reflet. Plus précisément, il faut faire apparaître dans le discours des fonctions qui ne sont pas simplement celles de l'expression (d'un rapport de forces déjà constitué et stabilisé) ou de la reproduction (d'un système social préexistant). Le discours - le seul fait de parler, d'employer des mots, d'utiliser les mots des autres (quitte à les retourner), des mots que les autres comprennent et acceptent (et, éventuellement, retournent de leur côté) -, ce fait est en lui-même une force. Le discours est pour le rapport des forces non pas seulement une surface d'inscription, mais un opérateur. » in M. FOUCAULT, « Le discours ne doit pas être pris comme… », La voix de son maître, 1976, pp.9-10. Cependant, fin des années 70, alors qu’il fait remonter son Histoire de la sexualité aux premiers siècles de notre ère, il découvre les techniques de soi qui relancent la question du discours ou dire vrai sur soi-même. Il préfère parler de « techniques de vérité » car il considère la question du discours depuis la question du sujet ou de la subjectivation : les techniques « sont des procédures réglées, des manières de faire qui sont réfléchies et sont destinées à opérer sur un objet déterminé un certain nombre de transformations. Ces transformations sont ordonnées à certaines fins qu’il s’agit d’atteindre à travers des dites transformations. » in M. FOUCAULT, Subjectivité et vérité, Cours au Collège de France, Paris, Gallimard, 2014, p.253 et M. FOUCAULT, Dire vrai sur soi-même, Conférences prononcées à l’Université Victoria de Toronto, 1982, édition, introduction et apparat critique par H.-P. Fruchaud et D. Lorenzini, Paris, Vrin, 2017.
65. DP, p.244.
66. « Les analystes anglais me réjouissent assez : ils permettent bien de voir comment on peut faire des analyses non linguistiques d’énoncés. Traiter des énoncés dans leur fonctionnement. Mais ce en quoi et ce par quoi ça fonctionne, jamais ils ne le font apparaître. Il faudrait peut-être avancer de ce côté-là. » Voir la lettre inédite de Michel Foucault à Daniel Defert, Daniel Defert, « Chronologie » in M. FOUCAULT Dits et écrits, tome 1, éd. Daniel Defert et François Ewald, Paris, Quarto Gallimard, 1994, p.40. Voir également « La pensée du dehors » in op. cit. : « Il faudra bien un jour essayer de définir les formes et les catégories fondamentales de cette « pensée du dehors ». Il faudra aussi s’efforcer de retrouver son cheminement, chercher d’où elle nouait et dans quelle direction elle va. »
67. Ibid. Voir également l’article : « Foucault répond à Sartre » (entretien avec J.-P. Elkabbach), La Quinzaine littéraire, n°46, 1er-15 mars 1968, pp.20-22, in M. FOUCAULT, Dits et écrits, tome 1, texte n°55, Paris, Gallimard, 1994.
68. R. JAKOBSON, Style in Langage, « Closing statements : Linguistics and Poetics », New-York, T.A. Sebeok, 1960. Trad. fr. Nicolas Ruwet : Essais de linguistique générale, « Linguistique et poétique », Paris, Éditions de Minuit, 1963.
69. F. de SAUSSURE, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, (1916) 2016 (NB. publication post mortem de notes de cours). À la suite d’études comparées des langues indo-européennes, il montre l’existence de type de sons qui ne sont pas présents dans les langues historiques mais qui expliquent la structure de certains mots. De là, il définit la langue comme un système de signes associant une partie acoustique (qu’il appelle le signifiant) et une partie conceptuelle (qu’il appelle le signifié), mais surtout cette association est déterminée par l’opposition avec les autres signifiants et les autres signifiés du système. En cela, les signes linguistiques ont une « valeur » qui dépend de l’ensemble du système dans lequel ils sont insérés. Et c’est la valeur différentielle des signes linguistiques entre eux qui donne le sens, c’est l’arrangement des mots et de ces signes qui fait la signification d’un discours. À ce titre, une langue est un système cohérent et autonome (une matrice) qui s’impose aux sujets parlants qui ne peuvent pas la modifier – aucun raisonnement ne peut conduire à préférer un son plutôt qu’un autre pour signifier un concept. Cela l’amène à distinguer le langage de la langue : le langage est la faculté générale de pouvoir s'exprimer au moyen de signes et la langue, l’ensemble de signes utilisés par une communauté pour communiquer : le français, l'anglais, l'allemand, etc. Au-delà de cette distinction, Ferdinand de Saussure différencie la langue et la parole. La parole est, pour lui, l'utilisation concrète des signes linguistiques dans un contexte précis.
70. En poursuivant les travaux de Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson s’intéresse à la partie acoustique : les sons des langues parlées ont une fonction, celle de communiquer un message. Selon lui, l’unité pertinente est le phonème : le son n’est phonème que s’il joue un rôle distinctif (ex dans « chat » et « rat », /ch/ et /r/ sont des phonèmes en français) car la substitution de l’un par l’autre entraîne un changement de sens. Et il est défini par l’ensemble des différences qui le distinguent de tous les autres phonèmes de la même langue. Mais il va encore plus loin en décomposant le phonème en une série de « traits distinctifs » considérés comme les constituants ultimes de toute langue et à l’origine de la notion de « structure » (ex /p/ et /b/ ou /m/ et /n/). Cette théorie combine à la fois universalité et relativité. De là, tout acte de parole devient un acte de communication verbale ; toute parole a comme fonction de « mettre en commun, communiquer » (du latin communicare) ces phonèmes et « traits distinctifs » pour partager des informations : l’important dans la communication, ce n’est pas ce que l’on dit mais ce que l’autre comprend. Dans ce cadre, Jakobson distingue alors six fonctions du langage nécessaires pour qu’il y ait communication.
71. M. FOUCAULT, « Analyse littéraire et le structuralisme », Folie, langage, littérature, op. cit., p.245 : « Un embrayeur (en anglais shifters) permet d’articuler l’énoncé sur la situation d’énonciation : adverbe de lieu ou de temps, démonstratifs, possessifs. »
72. E. BENVENISTE, « L’homme dans la langue », Problèmes de linguistique générale I, Paris, Gallimard, 1966.
73. E. BENVENISTE, « L’homme dans la langue », Problèmes de linguistique générale II, 1976, Paris, Gallimard, 1976 , pp.258-259.
74. E. BENVENISTE, « De la subjectivité dans le langage », Problèmes de linguistique générale I, Paris, Gallimard, 1966, p.260.
75. E. BENVENISTE, « Les niveaux de l’analyse linguistique », Problèmes de linguistique générale I, Paris, Gallimard, 1966, p.129.
76. E. BENVENISTE, « Structuralisme et linguistique », Problèmes de linguistique générale II, Paris, Gallimard, 1974, p.19.
77. E. BENVENISTE, « La nature des pronoms », Problèmes de linguistique générale I, Paris, Gallimard, 1966, p.251. Instances de discours ou actes de parole uniques.
78. E. BENVENISTE, « Les relations de temps dans le verbe français », Problèmes de linguistique générale I, Paris, Gallimard, 1966, p.241.
79. E. BENVENISTE, « Ce langage qui fait l’histoire », Problèmes de linguistique générale II, Paris, Gallimard, 1974, p.30.
80. Voir « La pensée du dehors » in M. FOUCAULT, Dits et écrits, op. cit. Réflexion inspirée par la linguistique mais aussi par ses lectures de Bataille, Blanchot, Klossowski, Barthes et Mallarmé.
81. Ibid.
82. Il en est de même des formes du sujet qu’il décrit à travers d’autres problématisations : la folie et le sujet fou, la naissance de la clinique et le sujet malade, le système pénitentiaire et le sujet délinquant, l’économie et le sujet travaillant, la biologie et le sujet vivant, la sexualité et le sujet sexuel.
83. Ibid.
84. Nous renvoyons à l’article de J. BENOIST, « Des actes de langage à l’inventaire des énoncés », Archive de Philosophie 79, 2016, pp.55-78.
85. L. J. PRIETO, Messages et signaux, Paris, PUF, 1966. cf. école linguistique de Paris d’André Martinet.
86. J. L. AUSTIN, How to Do Things with Words, Oxford, Clarendon Press, 1962. Foucault a eu connaisssance de ses cours avant la parution en français en 1970 : Quand dire, c’est faire, trad. fr. Gilles Lane, Paris, Seuil, 1970.
87. M. FOUCAULT, « Structuralisme et analyse littéraire », Conférence prononcée au Club Tahar Haddad à Tunis le 4 février 1967, Folie, Langage, Littérature, op. cit., pp.185-186. cf. exemple du cahier rouge posé sur une table donné par Prieto.
88. Ibid.
89. Pourquoi la littérature ? Voir supra : il est bien conscient qu’il a délaissé une grande partie des énoncés qui ne répondent pas aux règles des formations discursives (cf. L’archéologie du savoir).
90. HRED, feuillet [12].
91. Nous marquons une différence entre algorithme et IA. Un algorithme est une suite d’instructions permettant de résoudre un problème ou obtenir un résultat à partir de données – un algorithme comprend une question, des données, un calcul et un résultat. Euclide, Archimède, Erastoshène font déjà référence à des suites d'instructions précises et ordonnées permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat même si le nom n'est donné par un mathématicien persan (Al Khwarizmi) qu'au IXè siècle. On parle d’IA dès que l’on équipe un algorithme de fonctions ou capacités digitales cognitives ; les algorithmes prennent alors forme « concrètement », ils parlent, ils voient, ils planifient des actions, etc. Par exemple : les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les chatbots SAV, les assistants vocaux, les voitures autonomes, les montres connectées, les dispositifs médicaux actifs (DMA), la reconnaissance faciale, le GPS, etc. C’est en 1956 que John McCarty utilise la première fois le terme d’« intelligence artificielle » pour désigner « un domaine de l’informatique qui cherche à créer des systèmes capables de réaliser des tâches qui nécessiteraient normalement l’intelligence humaine » – les premiers systèmes sont modélisés dans les années 50 pour s’accélérer dans les années 90 avec la popularisation des fondements de l’Internet grâce au protocole WWW. Aujourd’hui, la définition de l’IA n’est pas précise en raison de sa nature étendue et sa constante évolution, néanmoins on parle généralement de trois types d’IA : « l’IA générale » (machine capable de réaliser n’importe quelle tâche cognitive comme le ferait un humain ou un animal – hypothétique encore à ce jour), «l’IA faible » (système capable de réaliser une tâche donnée de manière quasi parfaite sans supervision humaine – dans certains cas, on parle aussi de « machine learning » qui consiste à entraîner un programme ou un système informatique à effectuer des tâches sans instructions explicites, à partir d’un grand nombre de données, avec comme finalité de prévoir des résultats) et «l’IA forte » (modèle qui montre des signes d’une « conscience » propre – on parle aussi de « deep learning » : sous-ensemble du machine learning qui utilise des structures algorithmiques spécifiques appelées « réseaux neuronaux profonds » calquées sur le cerveau humain).
92. Notons que la géographie de la Silicon Valley dépasse largement les frontières de la seule Californie. À l’origine (épi)centre du développement et des innovations technologiques, elle reste aujourd’hui un lieu de décision et de conception – « sans usine » –, mais les contrats de sous-traitance et les partenariats sont délocalisés sur l’ensemble du continent américain, mais aussi en Europe, en Chine, en Inde, en Afrique.
93. Notons que depuis 1990, des ordinateurs quantiques travaillent non plus à partir du chiffre binaire, mais sur des données qubits qui permettent le traitement parallèle grâce à la propriété de superposition quantique. Cependant, il s’agit d’un usage encore très limité.
94. Voir Explication de l’arithmétique binaire, qui se sert des seuls caractères 0 et 1 avec des remarques sur son utilité et sur ce qu’elle donne le sens des anciennes figures chinoises de Fohy, par Gottfried Leibniz. Mémoires de mathématique et de physique de l’Académie royale des sciences, 1703.
95. Un grand modèle de langage, en abrégé LLM de l’anglais « large language model », est un type de programme d’intelligence artificielle qui exploite des nœuds (ou neurones) interconnectés dans une structure à plusieurs couches, similaire au cerveau humain, appelée « réseau de neurones profonds ». Ces nœuds sont soumis à une quantité massive de données (principalement de textes mais aussi à des images, des vidéos, des sons, des données financières, des langages informatiques, etc.) pour devenir de « réels » assistants ; cette structure permet aux ordinateurs d’apprendre de leurs erreurs et de s’améliorer en continu pour apporter des réponses aux requêtes ou tâches qui lui sont demandées. Voir liste des grands modèles de langage : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_mod%C3%A8le_de_langage
96. CNIL : la Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante française, membre de la GPA (Global Privacy Assembly).
97. La recette de cuisine est souvent citée comme l’exemple type de l’algorithme : toute recette commence par une question – par exemple : comment faire un gâteau au chocolat moelleux ? – suivie des données nécessaires, à savoir les ingrédients à sélectionner, les quantités à incorporer et les opérations successives à suivre en vue de réussir le plat en question. L’algorithme devient numérique (ou IA) lorsque la procédure se complexifie, c’est-à-dire lorsque le calcul revient à envisager trop d’actions simultanées. L’algorithme numérique (ou IA) prend, en quelque sorte, le relais de notre cerveau ; il/elle exécute à la place de l’être humain. cf. supra note 91.
98. En référence à G. SIMONDON, Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Aubier, 1958. Ajoutons que face à ce manque de transparence, de plus en plus de voix s’élèvent même au sein des géants de la Silicon Valley pour adopter des pratiques plus éthiques, sans néanmoins encore faire changer les choses en interne. Quelques sources journalistiques non exhaustives :
https://www.equaltimes.org/fievre-ethique-a-la-silicon-valley?lang=fr#.ZDp6vsHP3Oc
https://www.letemps.ch/opinions/silicon-valley-quete-dethique
https://www.ladn.eu/entreprisesinnovantes/transparence/travailleurs-de-la-tech-unissez-vous-et-ralez-un-bon-coup/
En outre, des organisations européennes et internationales bien conscientes du problème réfléchissent actuellement à un cadre réglementaire pour les algorithmes et l’IA. Le Parlement européen travaille notamment sur un « AI Act ».
99. DP, pp.246-247.
100. HRED. À propos des trois constatations, se référer au feuillet [55].
101. Nous renvoyons au concept de subjectivation/objectivation que Foucault aborde dans ses différents travaux : le sujet « n’est pas une substance » mais une forme qui n’est jamais identique à elle-même, il se transforme à travers des discours (vrais) qui vérifient les règles de formations des savoirs (ou la production du savoir et des discours de vérité) et valident des pratiques de pouvoir (ou les relations de pouvoir). C’est ainsi qu’il décrit l’émergence du « sujet fou » dans l’Histoire de la folie à l'âge classique, le « sujet malade » dans Naissance de la clinique, le « sujet parlant », le « sujet travaillant » et le « sujet vivant » dans Les mots et les choses, le « sujet criminel » et le « sujet délinquant » dans Surveiller et punir, le « sujet désirant » dans l’Histoire de la sexualité. Et il en va de même pour les choses dont le sujet dit qu’il parle.
102. cf. « Règle d’établissement du texte » in DP, pp.9-10 : « Manuscrit rédigé vraisemblablement pendant l’été 1966 ».
103. Nous rappelons que pour dégager les conditions de possibilité du savoir, Foucault construit sa méthode sur base de la critique kantienne tout en s’en distinguant : la critique n’est plus analytique, mais archéologique pour ressaisir, à partir de faits mis en relation, les conditions de possibilité (ou conditions d’acceptabilité) de la pensée à un moment donné pour neutraliser les énoncés positifs établis et définitifs, scientifiques et vrais, en fouillant en dessous de ce qui est « visible et énonçable » pour faire surgir la vérité, ou plutôt pour restituer les jeux de vérité. Très vite, il se rend compte que sa méthode doit aussi être généalogique étant donné que les choses ne sont plus inscrites dans aucun a priori ; il s’agit alors de remonter aux origines des conditions de possibilité de ces « singularités émergentes ».
104. DP, p.72.
105. M. FOUCAULT« Qu'est-ce qu’un philosophe ? » (entretien avec M-G Foy) [1966] in Dits et écrits, I, texte n°42, Paris, Gallimard, 1994, p.553. À propos du rôle du philosophe dans la société :
Foucault : « Vous savez, jusqu'au XIXe siècle, les philosophes n'étaient pas reconnus. Descartes était mathématicien, Kant n'enseignait pas la philosophie, mais l'anthropologie et la géographie, on apprenait la rhétorique, pas la philosophie, il n'était donc pas question pour le philosophe de s'intégrer [à la société]. C'est au XIXe siècle qu'on trouve enfin des chaires de philosophie ; Hegel était professeur de philosophie. Mais, à cette époque, on s'accordait à penser que la philosophie touchait à son terme. »
M-G Foy : « Ce qui coïncide à peu près avec l'idée de la mort de Dieu ? »
Foucault : « Dans une certaine mesure, mais il ne faut pas s'y tromper, la notion de mort de Dieu n'a pas le même sens selon que vous la trouvez chez Hegel, Feuerbach ou Nietzsche. Pour Hegel, la Raison prend la place du Dieu ; c'est l'esprit humain qui se réalise peu à peu ; pour Feuerbach, Dieu était l'illusion qui aliénait l'Homme, une fois balayée cette illusion, c'est l'Homme qui prend conscience de sa liberté ; pour Nietzsche enfin, la mort de Dieu signifie la fin de la métaphysique, mais la place reste vide, et ce n'est absolument pas l'Homme qui prend la place de Dieu. »
M-G Foy : « Oui, le dernier homme et le surhomme. »
Foucault : « En effet, nous sommes les derniers hommes au sens nietzschéen du terme, le surhomme sera celui qui aura surmonté l'absence de Dieu et l'absence de l'homme dans le même mouvement de dépassement. »
106. DP, p.74. Le « je dis que je parle » du sujet parlant s’étend aussi discours du philosophe : « Les paroles qui se prononcent, les textes qui s’écrivent, bref, toutes les modifications effectives du langage fixent d’une façon nouvelle les rapports entre les énoncés d’une part, et d’autre part celui qui les articule, le moment où ils sont prononcés et le lieu d’où ils sont ; les discours se rapportent autrement au présent et à l’ici de leur formulation, ainsi qu’au sujet qui parle à travers eux. Ce qui change, plus essentiellement que les choses dites ou les hommes qui les pensent en les disant, c’est l’implication du sujet parlant à l’intérieur du discours et la désignation de ce sujet parlant à l’extérieur de ce discours ; sur toute la surface du discours en général (c’est-à-dire de tout ce qui s’énonce dans une culture à un moment donné) apparaissent de nouvelles formes de cette implication désignatrice, chacune d’elles définissant un mode nouveau de discours ».
107. DP, p.105.
108. M. FOUCAULT, « Qu'est-ce qu’un philosophe ? », op. cit., p.553. Le texte original : « On peut envisager […] deux sortes de philosophes, celui qui ouvre de nouveaux chemins à la pensée, comme Heidegger, et celui qui joue en quelque sorte le rôle d'archéologue, qui étudie l'espace dans lequel se déploie la pensée, ainsi que les conditions de cette pensée, son mode de constitution ». Nous inversons ici les deux parties de la phrase originale par souci de cohérence syntaxique.
109. M. FOUCAULT, « Qu'est-ce que les Lumières ? » [1984], Dits et écrits, op. cit., p.681. Notons que si l’on se réfère au poème De la nature de Parménide, celui-ci montre qu’il y a de l’être, plus exactement, que la « vérité » ou l’alètheia (λήθεια en grec ancien) a pour fonction de dire ce qui est. Parménide dit, par la voix symbolique de la Déesse qui entraîne le char qui le porte, ce qui ou indique la voie de l’intelligence (entendons la méthode pour dire vrai) qui consiste à dire l’être, car, dans le cas contraire, la voie (entendons les autres chemins possibles) nous conduit au non-être qui est inconnaissable et impensable : « Allons, je vais te dire et tu vas entendre quelles sont les seules voies de recherche ouvertes à l’intelligence ; l’une, que l’être est. que le non-être n’est pas - chemin de la certitude, qui accompagne la vérité ; l’autre, que 1’être n’est pas. et que le non-être est forcément, route où je te le dis, tu ne dois aucunement te laisser séduire. Tu ne peux avoir connaissance de ce qui n’est pas, tu ne peux le saisir ni l’exprimer. » II, 1-8. La tâche de Parménide fût de montrer qu’il y a de l’être – principe des principes – et d’affirmer que prétendre expliquer la réalité sans faire appel à ce qui fait que les choses sont, c’est se perdre en chemin. Ne pose-t-il pas indirectement la possibilité du diagnostic ? Réflexion et analyse à poursuivre.
110. Foucault précise que la philosophie a toujours été une « entreprise de diagnostic » mais ce qui est nouveau, c’est la critique du diagnostic ; il ne suffit pas à identifier et reconnaître mais en dégager les conditions. C’est cela qui devient possible à partir du XVIIe siècle et évident avec Nietzsche : « À propos de Nietzsche, nous pouvons revenir à votre question : pour lui, le philosophe était celui qui diagnostique l’état de la pensée. » in M. FOUCAULT, « Qu'est-ce qu’un philosophe ? », op. cit.
111. DP, p.13.
112. Expression de F. GROS, Michel Foucault, Philosophie, Anthologie, Paris, Gallimard, Folio essais, 2004, p.19.
113. DP, p.254 et p.258.
114. Il faut attendre la fin des années 70 mais surtout le début des années 80, alors qu’il fait des allers-retours entre les textes grecs (cf. son enquête sur le généalogie du sujet) et les textes de Kant (Qu’est-ce que les Lumières ? (1784) et du Conflit des facultés (1798)), pour que l’idée de la philosophie comme diagnostic du présent redevienne centrale dans ses travaux et sa réfléxion et qu’il appelle alors « ontologie du présent » ou « ontologie critique de nous-mêmes » qui consiste à faire une critique des discours. Et à Foucault de conclure : « C’est cette forme de philosophie qui de Hegel à l’école de Francfort en passant par Nietzsche et Max Weber, a fondé une forme de réflexion dans laquelle j’ai essayé de travailler » in « Qu’est-ce que les Lumières ? », op. cit.
115. DP, p.17.
116. Nous n’avons pas insisté ici sur la subjectivation (du sujet), mais quelle que soit la « nature » de la « chose » (objet du monde ou sujet), elle enfonce ses racines dans le discours.